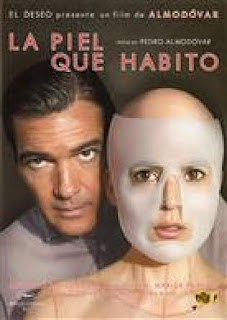« J’ai voulu détruire
quelque chose de beau. »
C’est l’histoire d’un salarié
dépressif et insomniaque, englué dans la société de consommation, qui soulage
ce mal-être en participant à des groupes de parole fréquentés par des personnes
en plus grande souffrance que lui. Ces réunions sont « parasitées »
par la présence d’une fille paumée, ce qui l’importune. Il lui propose alors de
se répartir les jours de la semaine afin de ne plus se croiser. Un jour, après
que son appartement ait accidentellement pris feu, il rencontre l’énigmatique Tyler
Durden, qui lui parle d’un club de combats clandestins dont il est l’initiateur.
Mais Tyler est-il réel ou n’est-il qu’une création, un double fantasmé de notre
héros ?
Y’a qui dedans ? Brad Pitt,
après Seven, retrouve Fincher pour ce rôle de Tyler Durden. Edward Norton,
révélé dans Peur primale (1996) et American History X (1998), confirme son
talent pour les rôles ambigus dans celui de ce salarié déprimé. Helena Bonham
Carter (qui ressemble à Anouk Grinberg dans Merci la vie, genre « femme-enfant »)
vient apporter la touche féminine dans cet univers très « pour nous, les
hommes ».
Et c’est bien ? Fincher, j’aime
bien. Mis à part The Social Network (2010), j’ai vu tous ses films jusqu’à Gone
Girl (2014) inclus. Même si je n’en ai qu’un seul dans ma DVDthèque (l’incontournable
Seven), ses scénarios m’intéressaient suffisamment pour que j’y jette un œil à
chaque fois. Paradoxalement, si ce Fight Club controversé, emblématique de la « Génération
X » (la mienne, NDLR) et désormais culte m’avait impressionné à l’époque, je
ne suis aujourd’hui pas loin de le placer plutôt en bas de classement parmi les
réalisations du cinéaste. Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, des effets de
mise en scène un peu « tape-à-l’œil ». Fincher vient du clip (Madonna,
Billy Idol, Aerosmith, Michael Jackson, les Stones…) et ça se ressent
particulièrement ici. Heureusement, il adoptera par la suite un style bien plus
classique et mature. D’autre part, le « twist » final, invraisemblable
et somme toute plutôt moral (mis en musique par le Where Is My Mind ? des
Pixies), de ce que j’en ai compris (un homme, une femme et on repart de zéro sur
des bases plus saines). Cette adaptation cinématographique du roman éponyme de
Chuck Palahniuk a fini par devenir un film de chevet dans les cercles « virilistes »
et MGTOW (de droite et son extrême, donc). Le refrain est connu : « le
salariat et le confort consumériste, ça ramollit. Après, ça fait des pédés et
on perd les guerres ». Ce qui est paradoxal sachant qu’ils sont par
ailleurs extrêmement favorables au capitalisme, système entièrement basé sur…
la consommation. Mais on n’est pas là pour philosophailler et chacun y verra bien
ce qu’il veut. Qu’il soit « facho » ou libertaire, Fight Club est
certes spectaculaire, parfois (légèrement) drôle et bien fait mais aussi un peu
toc, versant dans la provoc facile et la violence gratuite.
Savon : oui
Pingouin : oui
Femme à poil : oui mais acte
sexuel stylisé (Helena Bonham Carter)