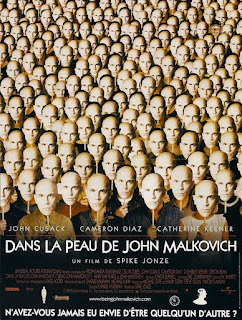« Moi, les femmes, c’est
comme les truffes pour les cochons. »
« S’engager sur quoi ? Le Moyen-Âge est passé depuis longtemps… »
C’est l’histoire de Bruno Cortona (Vittorio Gassman), un quarantenaire exubérant, amateur de conduite automobile et de jolies femmes, à la recherche de cigarettes et d’un téléphone public en ce 15 août férié à Rome. Il va faire la connaissance de Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant), un étudiant en droit quant à lui plutôt du genre réservé. Ensemble, ils vont passer deux jours sur les routes, ce qui constituera pour Roberto un voyage initiatique concernant l’amour et les rapports sociaux.
Voila venu le moment de me
plonger, petit à petit, dans le cinéma italien, qui n’est pas du menu fretin dans
l’histoire du 7ème Art (euphémisme). J’ai dû voir deux Fellini (La
strada et Amarcord) et, chroniqués sur ces pages, Le pigeon de Mario Monicelli
(qui vaut surtout pour son incroyable « twist » final) et La grande
bouffe du provocateur Marco Ferreri. Mais j’ai surtout un bon souvenir du diptyque
à sketches Les monstres / Les nouveaux monstres, œuvres, totalement ou en
partie, de Dino Risi. A la manœuvre de ce Fanfaron qui nous occupe aujourd’hui,
au doux parfum de « chef-d’œuvre de la comédie à l’italienne ».
Problème : je n’ai pas (sou)ri un seul instant. Ennuyeux, pour une comédie…
Le « fanfaron » en question, c’est Vittorio Gassman, insupportable de
volubilité et de sans-gêne, ricanant et klaxonnant dès qu’il en a l’occasion. Un
vrai « rital », en somme. Le film se veut une satire de la société
italienne de ce temps-là, en plein « boom économique » (1958-1963).
Mouais, admettons… Même si le consumérisme, la cupidité, la bêtise et l’absence
de valeurs morales sont universels. Aucun gag à se mettre sous la dent et des
longueurs pour cette réalisation, à la fois « buddy movie » (même s’il
n’est pas répertorié tel quel) et « road movie », qui s’achève de
façon tragique, symbolique, amorale et, en y réfléchissant bien, prévisible.