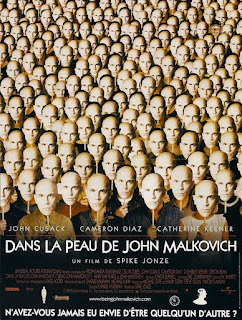« La vie est là, qu’est-ce
que tu veux… Il faut bien la vivre... »
C’est l’histoire d’une dizaine de comédiens convoqués post-mortem par le dramaturge Antoine d'Anthac (Denis Podalydès). Celui-ci leur projette la captation filmée d’une mise en scène de sa pièce Eurydice, qu’ils ont tous joué naguère, interprétée par une jeune troupe afin de connaître leurs impressions.
Ouais ben, j’aurais mieux fait de ne rien voir… Autant j’aime généralement bien Resnais (mort à Neuilly), autant celui-là est redoutablement chiant. Nous sommes amenés à regarder des comédiens qui jouent leur propre rôle en train de regarder une célèbre pièce de théâtre jouée par d’autres comédiens, en herbe ceux-là. Et devant ce spectacle, les souvenirs se ravivent et les spectateurs se mettent eux aussi à rejouer la pièce. Les rôles principaux Orphée et Eurydice passent ainsi alternativement du couple Arditi-Azéma à celui composé de Lambert Wilson (né à Neuilly) et Anne Consigny et à celui des jeunes comédiens. Même si c’est fatalement l’immuable duo Arditi / Azéma qui se taille la part du lion (pas de Dussollier en revanche pour cette fois, il devait avoir piscine…), on imagine que la production a dû faire preuve de diplomatie afin de ne froisser aucun égo, en donnant à chacun et chacune son quota de scènes et de temps à l’écran. A ce petit jeu, Mathieu Amalric (né à Neuilly) s’en sort plutôt bien. Partez pas avant la fin, y’a une surprise : Podalydès (né à... Versailles) n’est en fait pas mort (ça alors !). Enfin, pas tout de suite car il cassera sa pipe juste un peu plus tard. Mais qu’importe puisque sa pièce continue d’être jouée. Qu’est-ce qu’on s’amuse…