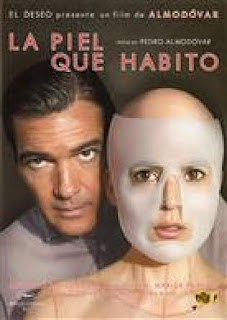« Avec Paulot ? Il
est gentil mais ça suffit pas. »
C’est l’histoire de la jeune Nina (Juliette Binoche), qui quitte la province pour s’installer à Paris en vue d’une carrière de comédienne. Elle trouve refuge chez Paulot (Wadeck Stanczak), modeste agent immobilier qui l’héberge avant de lui trouver un appartement. Ce dernier vit en colocation avec le ténébreux Quentin (Lambert Wilson), acteur dans des théâtres érotiques. Paulot aime Nina mais celle-ci est plus sensible au charme de Quentin, qui décède brutalement un soir en sortant de chez elle, écrasé par une voiture.
Vous l’aurez compris en jetant un simple coup d’œil sur la jaquette : il va beaucoup être question de cul, ici. La belle Juliette y lance quasiment sa (brillante) carrière, en cette féconde année 1985 (pas moins de six films où elle est à l’affiche sortis cette année-là !). Et elle le fait « corps et âme »… Le premier est inspecté sous toutes les coutures : deux scènes où elle montre ses seins, une où Wilson pose sa tête sur son ventre, avec sa chatte sous le nez et deux autres où elle est allongée sur le ventre, les fesses à l’air (dont une où Wilson lui glissera la main dans sa fente). Avec le recul de l’ère #MeToo, y’a comme qui dirait de l’abus... Autant se mater un bon boulard, au moins y’aurait pas d’ambiguïté. Pour ce qui est de l'« âme », elle sera amenée à chialer en deux ou trois occasions. Bon, donc en gros, l’histoire, c’est le gentil petit agent immobilier qui reste confiné dans la « friend zone ». Ben oui, mon Paulot, t’es trop lisse, il en faut plus pour les faire mouiller, ces grognasses. Elles préfèrent les « chads » ou les mecs « mystérieux », même s’ils sont suicidaires comme ici. Elles veulent « ressentir des émotions », quoi… Même mort, Wilson continue d’obséder Binoche mais le Paulot parviendra tout de même à ses fins en la baisant bien comme il faut (pauvre Juliette, elle se fait cracher deux fois au visage par Stanczak avant qu'il ne le lui léchouille...) dans l’arrière-boutique de son agence, à l’heure de la fermeture. Tout en prenant soin de la larguer juste après, comprenant qu’elle n’est pas pour lui. T’as bien fait, mon Paulot, elle t’en aurait fait voir de toutes les couleurs, cette nana-là et comme Patriiiiiiiiiick, t’en aurais eu marre…